Entre le 21 décembre et le 1er janvier, j’aurais passé 18 heures dans un train. 8 trajets. Gares de Bernay, Houdan, La Loupe, Lyon, Montélimar, Paris, Quimper.
***
Dimanche 21 décembre, Houdan-Paris
Immense flemme. (Je ne savais pas que je rentrais pour voir une des pièces de théâtre les plus folles que j’ai jamais vue.) Chips. Podcast sur « La Grande évasion ». Je réalise que je vais beaucoup prendre le train. J’ai l’idée de tenir cette liste de voyages sans savoir pourquoi.
13h08 à 14h06

Lundi 22 décembre, Paris-Bernay
Surexcitée à l’idée de partir. Matinée vécue à toute vitesse. Beaucoup de monde à la gare. Le « Requiem » de Mozart passe et fait son effet au milieu de la foule. L’urgence de Noël. J’écris quelque chose, garde la tête vissée vers la fenêtre durant tout le trajet. Je lis le journal de l’Odéon sur Pétrole de Pasolini (mise en scène de Sylvain Creuzevault) pendant que ma voisine regarde Emily in Paris. Elle a bien soixante ans, et moi vingt-sept. Croque-monsieur froid. Eau. J’ai encore trop acheté à manger. Une femme dans le wagon est rousse et odieuse. Un homme ronfle derrière elle. Une mère signale à la personne à côté d’elle qu’elle entend toute sa musique à travers son casque. Rires gênés. Les valises dégueulent dans l’allée. Les gens emballent leurs cadeaux sur leur siège comme on changerait une couche sur une table à langer. Peu avant d’arriver, j’aimerais que cela ne se termine jamais. Ma voisine range ses affaires avant moi et me demande si le train s’arrête bien à Bernay, si j’y descends. J’acquiesce et la rassure. Le train stoppe en gare. Je me lève. Elle ne descend pas.
« The audience should also stop being protected. The world of art, with all its institutions has become a place concentrating in protecting the audience (because of an interest in educating it or the intuition of entertaining it.) » Tania Bruguera, Autosabotage – En-tête du journal de l’Odéon que je recopie dans mon carnet. Le papier journal sent très fort l’encre.
13h56 à 15h23

Jeudi 25 décembre, La Loupe-Paris
Coucher de soleil et crise de foie. Impossible de lire une ligne ou de regarder le paysage rougeoyant. Paupières lourdes. Première fois que je m’endors dans un train bondé post-réveillon.
16h27 à 18h
Vendredi 26 décembre Paris-Lyon
Premier train de la journée. Café + scone + chips + sandwich jambon fromage cornichons.
Lecture : La cloche de la détresse de Sylvia Plath.
Le mec assit derrière moi ne parle que de son ex-femme à sa compagne de voyage. C’est une prise d’otages. Un couple de soixantenaires parlent de capotes et de l’Autriche. Un autre couple essaye de ne pas épingler leurs deux enfants. Le père leur prépare des tranches de pain de mie complet avec du fromage à tartiner. La campagne est plongée dans la brume, recouverte d’une neige poudreuse.
La cloche est si bien écrit. Le texte met face à une réalité silencieuse et glaçante qui se loge dans les os. Sylvia Plath la recouvre d’une couverture chauffante en sachant très bien qu’elle risque de l’électrocuter.
Je ne me rappelle plus qui m’a dit que les anglais mangeaient leur irrévocable « bag of crisps » chaque fois qu’ils grignotaient. J’ai les doigts pleins de sel.
La voix du conducteur de train espère que nous avons fait un bon voyage. Elle ajoute « n’oubliez pas vos bagages, et éventuellement vos enfants. »
Je n’ai que 20 minutes pour changer de train vers Montélimar.
11h à 12h56

Vendredi 26 décembre, Lyon-Montélimar
Une adolescente s’assoit à côté de moi. Sa petite soeur grimpe sur ses genoux. Elle tire sur les deux cordons de son sweat en disant « Regarde, je fais la taille. »
La grande la regarde sans rien dire. La petite garde les yeux baissés et lui demande :
« Tu crois en Dieu ?
– Oui. Tu sais bien, puisque j’ai été à la messe hier. »
La petite hausse la tête.
« Et toi ? Demande la grande.
– Non.
– Non, tu n’as pas été à la messe, mais tu crois en Dieu, oui ? »
La petite acquiesce mais ne dit rien. Elles se regardent longuement, sans plus échanger un mot. Elles descendent au premier arrêt, Vienne, et un instant, j’ai la sensation de m’être trompée de train. Une seconde de confusion à l’idée d’avoir atterri dans un autre pays sans le faire exprès.
La voix du conducteur de train annonce les correspondances sur les voies « B comme Bravo » et « F comme Foque ».
Le train est propice à jouir de son propre silence. J’ai quitté la gare-fourmilière pour m’enfoncer vers les terres alpines. Le soleil est froid et me brûle les joues. Je vois leur reflet rougi dans la vitre. Est-ce qu’il serait possible de prendre un billet de train dont le terminus ne serait que le moment où nous déciderions d’en descendre ?
Une femme doit sortir à un arrêt que je n’ai pas noté et hurle « Putain ! J’ai perdu mes clés de voiture !! » Je ne sais pas si elle a fini par descendre. Autour des rails et du quai vide, il n’y a rien que des arbres dévêtus, des champs boueux et des usines vides.
Le Drôme m’a toujours parue triste. Peut-être que c’est parce que ce n’est ni tout à fait la montagne, ni tout à fait le Sud, ni tout à fait la mer.
13h20 à 14h56
Lundi 29 décembre, Montélimar-Paris
La route a été longue depuis le village dans les montagnes. Il fait un froid polaire sur le quai de la gare et le train a du retard. Un homme dort à côté de moi pendant tout le trajet. Un chat roux miaule une longue plainte. Je ramène avec moi deux petits objets en céramique pour mon studio. Ils sont chacun dans un sac en papier. Voyager avec ces deux coupelles si délicates n’est pas facile. Je dois surveiller mes mouvements, ceux du train et ceux des autres pour m’assurer qu’ils ne se brisent pas. Beaucoup de monde tousse. L’homme qui dort est enrhumé lui aussi. Il laisse tomber ses mouchoirs usagés autour de lui, quand sa main desserre lentement son emprise sur eux, à mesure qu’il bascule dans le sommeil.
Il fait nuit noire dehors. Je ne vois que des reflets. L’image est double, légèrement décalée dans la vitre. Médicament contre la migraine. Je regarde The Dreamer, une série sur l’écrivaine Karen Blixen qui me donne envie de me replonger dans La ferme africaine. Après tout, c’est l’ouvrage que lit Holden Caulfield. Je me sens très attachée au récit de la vie de Blixen. Son égo est remarquable. Tout comme Germaine Krull, elle a vécu plusieurs vies. Il apparaît que ce serait la recette pour écrire sans faire aucune concession sur le reste.
Cette fin d’année est étrange, brutalement excitante. Je prends beaucoup de plaisir à trouver ce que je n’ai pas cherché.
19h03 à 22h06

Mardi 30 décembre, Paris-Quimper
Il est tôt. L’avant-dernier épisode de la série sur Karen Blixen me dit que le seul moyen de façonner un être aimé qui nous échappe à l’image que l’on souhaite est de l’écrire. « Pâté en croute, filet mignon et porc séché, un yaourt et une bonne bouteille de vin » dit l’homme qui parle fort quelque part autour de moi. Un café (pas suffisant). Je lis Sylvia Plath et La ferme africaine. Le paysage sort de la nuit quand nous avons quitté Rennes avec 20 minutes de retard. Nous ne devrions pas être retardés davantage « si rien ne s’y oppose » dit la voix du conducteur de train.
Karen Blixen décrit sa ferme au Kenya tandis que nous avançons au milieu des champs cultivés de la campagne. L’homme assit à côté de moi s’appelle Alessandro. Il dort pendant tout le trajet, son visage dissimulé sous sa casquette. Il est brun et barbu, ses sourcils sont sombres et épais. Il porte des vêtements qui lui donnent une apparence tendre et douce. Un pantalon en velours côtelé couleur sable mouillé et un pull bleu marine tricoté. L’idée de m’endormir sur son épaule me traverse l’esprit. Il n’a rien d’autre sur sa table que sa paire de lunettes de vue et son téléphone. Il ne s’en sert qu’une fois, pour géolocaliser son emplacement. Sur ma table, il y a :
- Un carnet
- Un stylo
- Une paire de lunettes
- Mes écouteurs
- Un paquet de mouchoirs
- Mon gobelet de café en carton (vide)
- Le marque-pages en argent que ma mère m’a offert à Noël. Il vient du Mali et ressemble davantage à un bijou que l’on glisserait dans ses cheveux. Il est fait d’une tige pliée en deux gravée de motifs avec une ambre d’un côté et une pointe fine de l’autre qui ressemble à un minuscule poignard.
- Mon téléphone
Alessandro descend à Vannes. Je ne verrai jamais entièrement son visage.
7h à 10h28
Jeudi 1er janvier, Quimper-Paris
Je suis triste de prendre le train. Je n’ai jamais autant ri à un nouvel an au point d’avoir des larmes.
Je me sens moi-même, que je sois heureuse ou mélancolique. J’espère que je n’oublierai pas ce sentiment que j’éprouve.
J’écris quelques mots secrets sur l’année à venir. Tolkien me tient compagnie.
15h37 à 19h34


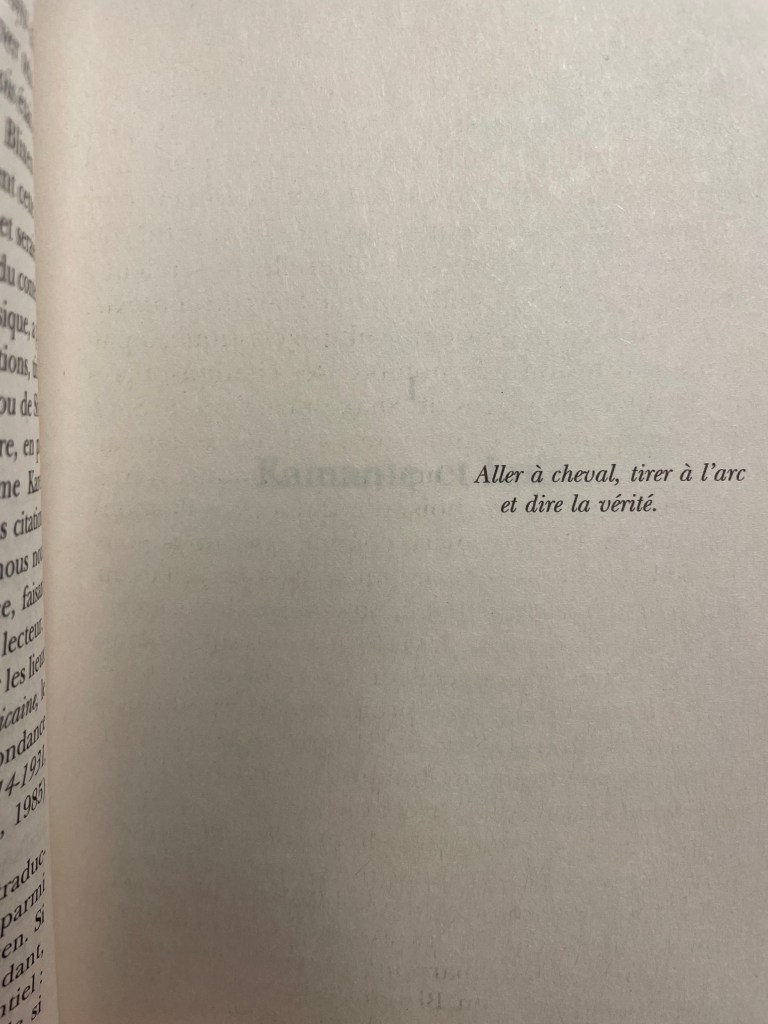
Laisser un commentaire